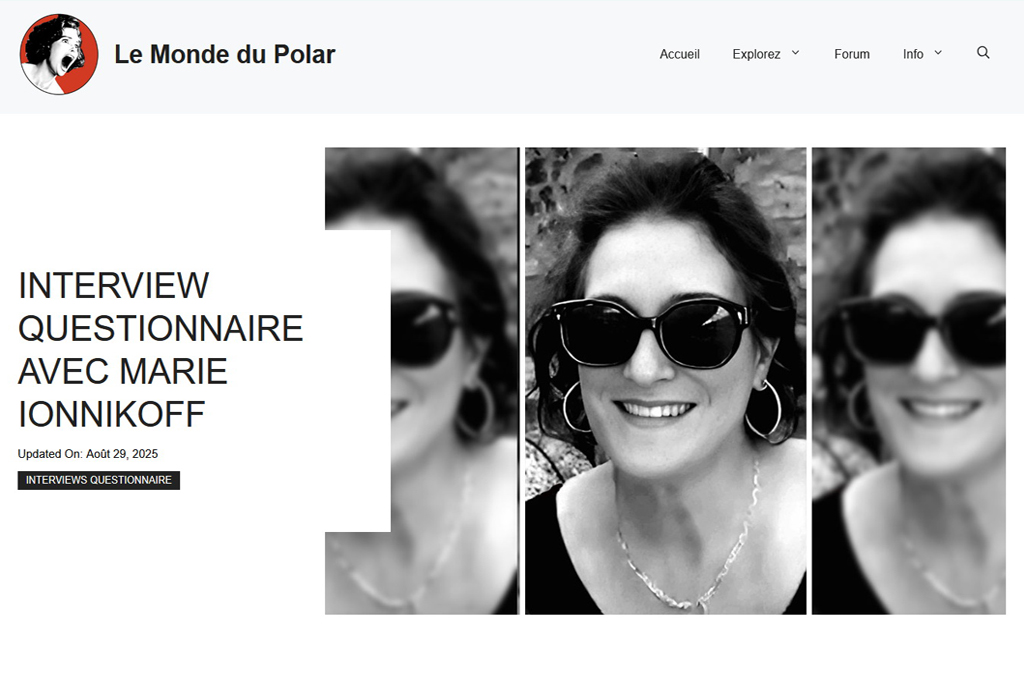Parmi les projets littéraires qui jalonnent une vie d’auteur, il y a les romans — ces territoires vastes, exigeants, où l’on s’installe longtemps — et il y a les chemins de traverse. Des invitations ponctuelles, des ouvrages collectifs, des expériences qui déplacent l’écriture et la regardent sous un autre angle.
Certains de ces projets ont une résonance particulière parce qu’ils s’inscrivent dans une démarche caritative. Prêter sa plume, alors, ne relève plus seulement d’un exercice littéraire : c’est un geste de partage.
J’ai eu la joie de participer à l’ouvrage collectif « Des Histoires complètement Dindes », au bénéfice de l’association Les Enfants de la Terre. Écrire pour un projet destiné à soutenir une cause, et qui s’adresse à toute la famille, m’a invitée à explorer un registre différent : une nouvelle accessible, lumineuse, capable de rassembler petits et grands autour d’une même histoire.
Un autre projet collectif verra le jour au printemps 2027, toujours dans cette volonté de conjuguer littérature et solidarité. Là encore, je prête ma plume dans le cadre d’une nouvelle destinée à un lectorat familial. J’aurai l’occasion d’en parler plus longuement en temps voulu, lorsque le projet se dévoilera.
Aujourd’hui, j’aimerais m’arrêter sur une expérience d’une nature différente : le calendrier de l’Avent organisé par McAdam Kilter, à travers Les_Chroniques_de_mcadam sur Bookstagram.
Ici, point d’ouvrage relié ni de volume collectif au sens traditionnel, mais une constellation de micro-nouvelles publiées jour après jour sur Instagram du 1er au 25 décembre. Un rendez-vous quotidien, une voix différente derrière chaque date. Un exercice bref, précis, presque acrobatique.
Cette année, j’y ai participé avec une micro-nouvelle intitulée « Le treizième invité ».
Un titre qui suggère déjà une anomalie. Une chaise en trop. Un couvert de plus. Une présence qui ne devrait pas être là.
Mais avant de parler de cette nouvelle, il me faut dire pourquoi j’aime tant ces projets.
La contrainte comme respiration
Lorsque l’on travaille sur un roman — surtout lorsqu’il est psychologique, dense, exigeant — l’écriture devient un long souffle. Une plongée continue. On s’installe dans une voix, un rythme, une tension. On creuse. On polit. On revient. On doute. On reprend.
Le roman est une architecture. Il demande de la persévérance, une fidélité presque obstinée.
La nouvelle, elle, est un éclair.
Participer à un calendrier de l’Avent littéraire, c’est accepter un cadre précis : un format court, une publication sur un réseau social, une lecture rapide — mais marquante. Dans le cas du projet de Mc Adam, il s’agit de micro-nouvelles. Un exercice hautement acrobatique.
Tout doit être dit — ou suggéré — en très peu de mots.
Il n’y a pas la place pour l’explication. Pas le luxe de la lenteur. Chaque phrase compte. Chaque mot porte son poids exact. Il faut tailler. Élaguer. Écouter la phrase jusqu’à ce qu’elle sonne juste, puis la réduire encore, sans la briser.
C’est une discipline presque musicale.
On coupe une syllabe, et la cadence change.
On déplace un adjectif, et l’ombre s’épaissit.
On supprime une précision, et le silence devient signifiant.
J’aime profondément cette économie.
Dans la brièveté, il n’y a plus de gras. Il n’y a que l’os.
Un « moratoire » d’écriture
Je parle parfois de ces projets comme d’un « moratoire » d’écriture. Le mot est peut-être surprenant. Il évoque une suspension, un arrêt temporaire. Et pourtant, c’est exactement cela : une pause dans le chantier principal, non pour cesser d’écrire, mais pour écrire autrement.
Quand on travaille longtemps sur le même univers, le même ton, la même tension intérieure, on risque l’asphyxie. L’esprit a besoin d’air. De déplacement. De jeu.
Écrire pour un projet collectif, c’est s’accorder ce déplacement.
On change de focale.
On change de registre.
On change parfois même de genre.
L’année dernière, dans le cadre du même calendrier, j’avais proposé une micro-nouvelle intitulée : Felicitas fragilis est ». Un texte écrit du point de vue d’un criminel. Un exercice que je redoutais.
Je me souviens de la jubilation presque dangereuse qui accompagnait cet exercice. Se glisser dans la tête de celui qui agit, qui calcule, qui justifie. Écrire depuis la fissure morale plutôt que depuis la victime. Explorer l’intime obscur.
C’était une expérience troublante, presque inconfortable. Mais féconde.
Car écrire, c’est aussi cela : approcher les zones qui dérangent, s’installer dans une perspective qui n’est pas la sienne, accepter d’entendre une voix intérieure qui ne nous ressemble pas.
Cette année, avec Le treizième invité, j’ai emprunté un autre chemin.
Le conte fantastique : le frisson et l’enfance
J’ai toujours été sensible au fantastique —avec Maupassant notamment— non pas au spectaculaire, mais à l’infime décalage. À cette ligne très fine entre le réel et ce qui le fissure.
Le conte fantastique possède une puissance particulière : il convoque l’enfance et l’inquiétude dans un même mouvement. Il installe un décor presque familier, puis introduit un élément dissonant. Quelque chose qui cloche. Qui insiste. Qui ne s’explique pas.
Dans Le treizième invité, j’ai voulu écrire un conte glaçant.
Un texte bref, mais habité d’une présence.
Le nombre treize, déjà, porte en lui une charge symbolique. Il évoque la superstition, la rupture d’équilibre, la malchance. Il désigne celui qui dépasse la limite. Celui qui est en trop.
Dans un conte, le chiffre n’est jamais neutre. Il est signe.
Écrire ce texte a été un jeu — un jeu sérieux, évidemment. Trouver la bonne atmosphère en quelques lignes. Installer une table, des convives, une attente. Puis laisser l’étrangeté s’infiltrer, doucement, sans bruit.
Ce qui m’a particulièrement plu, c’est le travail de suggestion.
Ne pas tout montrer.
Ne pas tout expliquer.
Faire confiance au lecteur.
Dans un roman, on peut développer une tension psychologique sur des dizaines de pages. Dans une micro-nouvelle, la tension doit naître presque instantanément. C’est une étincelle. Si elle ne prend pas, tout s’éteint.
Le fantastique se prête admirablement à cet exercice. Il repose sur l’ellipse. Sur le non-dit. Sur l’entre-deux.
A lire aussi
L’acrobatie du peu
Écrire court est une discipline sévère.
Il faut accepter de renoncer à des phrases que l’on aime. À des images séduisantes mais superflues. À des détours qui, dans un roman, seraient des respirations légitimes.
Ici, tout doit servir l’impact.
Je travaille ces micro-nouvelles comme on polit un galet. Je les écris d’abord trop longues. Puis je coupe. Je reviens. Je supprime encore. Je lis à voix haute. J’écoute la chute.
Car la chute est essentielle.
Dans une micro-nouvelle, la dernière phrase agit comme un battement de porte. Elle doit laisser une trace. Une résonance. Un léger vertige.
C’est un exercice que je trouve extrêmement formateur. Il oblige à une précision accrue. Il affine l’oreille. Il développe une vigilance presque instinctive face au mot inutile.
Paradoxalement, cette contrainte nourrit ensuite mon travail romanesque. Elle m’apprend à être plus exigeante, plus attentive à la densité de chaque phrase.
Explorer d’autres genres : une liberté salutaire
Mon univers romanesque est souvent ancré dans le noir psychologique. L’exploration des failles intimes, des obsessions, des dérives. C’est un territoire que je connais bien, que j’habite avec intensité.
Mais participer à des projets comme le calendrier de l’Avent de McAdam me permet d’élargir ma palette.
L’année dernière : la voix d’un criminel.
Cette année : le conte fantastique.
Demain, peut-être, l’anticipation. Ou l’humour noir. Ou la fable.
Ces incursions ne diluent pas mon identité d’auteure. Elles l’enrichissent.
Elles me rappellent que la littérature est un terrain de jeu immense. Que l’on peut s’y déplacer librement. Que l’on peut essayer, échouer, recommencer. J’aime ces « laboratoires » d’écriture.
Dans un projet collectif, il y a aussi une dimension stimulante : celle du dialogue implicite avec d’autres auteurs. Chacun apporte sa couleur, son rythme, son univers. Ensemble, nous composons une constellation de textes.
Je trouve cela profondément beau.
Instagram : un autre rapport au lecteur
Le choix de publier ces micro-nouvelles sur Instagram ajoute une dimension particulière. Le texte apparaît dans un flux d’images, de vidéos, de messages rapides. Il doit capter l’attention sans crier.
C’est un autre défi.
Le lecteur découvre la nouvelle sur son téléphone, peut-être entre deux rendez-vous, dans un train, dans une salle d’attente. Le temps de lecture est bref. L’impact doit être immédiat.
Cela m’oblige à penser l’ouverture avec soin. La première phrase est un seuil. Elle doit inviter, intriguer, happer.
Mais ce format offre aussi une proximité précieuse. Les retours sont rapides. Les réactions spontanées. On sent presque physiquement la lecture.
J’aime cette circulation vivante.
Ce que ces projets m’apprennent
Si je devais résumer ce que ces expériences m’apportent, je dirais :
– Elles m’apprennent la concision.
– Elles m’apprennent le courage de couper.
– Elles m’apprennent la souplesse.
– Elles m’apprennent le jeu.
Écrire ne doit pas devenir une rigidité. Même lorsque les thèmes sont graves, même lorsque les univers sont sombres, il doit rester une part de plaisir. Une part d’élan.
Avec Le treizième invité, je me suis amusée. Vraiment.
J’ai aimé installer le décor. J’ai aimé distiller le malaise. J’ai aimé écrire cette présence invisible qui finit par s’imposer.
Et j’ai aimé l’idée que ce texte, si court soit-il, puisse accompagner un lecteur un soir de décembre, à la lueur d’une guirlande ou dans le silence d’une chambre.
L’éphémère et la trace
Une micro-nouvelle publiée dans le cadre d’un calendrier de l’Avent a quelque chose d’éphémère. Elle apparaît un jour précis, puis laisse place à la suivante. Elle s’inscrit dans une succession.
Et pourtant, elle demeure.
Je crois profondément que la brièveté n’est pas l’inverse de la profondeur. Un texte court peut laisser une empreinte durable. Il peut ouvrir une question, réveiller une peur, faire naître une image persistante.
Le treizième invité n’est peut-être qu’une silhouette. Mais parfois, les silhouettes sont plus inquiétantes que les visages.
Je vous invite à découvrir cette micro-nouvelle ci-dessous.
Peut-être reconnaîtrez-vous le moment précis où le réel bascule.
Peut-être sentirez-vous, vous aussi, cette chaise en trop.
Et si, à la fin, vous avez le sentiment qu’une présence s’est glissée derrière votre épaule, alors l’exercice acrobatique aura tenu sa promesse.
Le treizième invité
La maison scintille dans la nuit gelée. Le gravier crisse sous les pas, l’air sent la résine et le feu de bois. À l’intérieur, une douce chaleur vous enlace. Les guirlandes clignotent, le sapin croule sous les boules colorées. Les flammes de la cheminée projettent sur les murs des reflets dansants. Les voix se mêlent, joyeuses. Un brouhaha dense, entêtant.
Les assiettes sont pleines, les verres se lèvent, les rires fusent. Douze convives. C’est ce qu’ils disent. On plaisante, on trinque, on s’étreint. L’air est saturé d’odeurs : dinde fumante, marrons grillés, cannelle… Le bonheur exhalant de ce foyer est communicatif. L’illusion est parfaite.
L’enfant de la maisonnée, sagement installé en bout de table, chuchote ce qui ressemble à une mélopée. Serait-ce une comptine de Noël ? Sa voix fluette se fait progressivement plus audible. Il compte. Ses doigts tapotent la nappe blanche. Ses lèvres articulent chaque chiffre. Dix, onze, douze, treize… Treize, répète-t-il soudain plus fort. Treize. Le mot tombe, net, dissonant. Silence. Puis les rires reprennent. L’enfant se trompe, forcément. Douze, voyons. Douze comme chaque Noël ! On le rassure, on s’esclaffe pour couvrir sa voix. Treize, répète-t-il toutefois. Son regard ne cille pas, étrangement adulte. On balaie son sérieux d’un geste, on l’accuse de mal voir, de mal compter. Quoi qu’il en soit, on ne cédera pas à la superstition ! Il insiste. Treize. Treize, un chiffre qu’il psalmodie maintenant de manière lancinante, les prunelles fixées sur un emplacement vide.
On détourne l’attention. On découpe la viande, on verse le vin, on relance les conversations… Néanmoins, une assiette demeure de trop. Nul ne se souvient l’avoir posée. Elle est là, pourtant, dressée avec soin. « À la vôtre… », souffle une voix éraillée. Personne ne relève, mais chacun a entendu. On détourne les yeux, on s’agite, on boit. Les discussions s’éraflent, trébuchent. La dinde fume, mais les odeurs réconfortantes n’effacent pas la faille. La nappe tremble d’un courant d’air glacé. Les flammes des bougies vacillent comme soufflées de l’intérieur. Une chaise grince. Vide. Mais déplacée. On la remet d’aplomb, d’un geste nerveux, et déjà l’enfant murmure : « Il s’assoit… »
Les adultes parlent plus fort, feignent l’insouciance. Ils racontent des anecdotes, rient. Mais leurs sourires forment des grimaces, leurs yeux se fuient, leurs verres restent pleins. Et sous les éclats de voix, d’autres mots circulent, discrets, acérés : prénoms, dates, souvenirs intimes, fautes, traîtrises. Chacun les reconnaît. Personne ne veut les avouer. Les regards se croisent, trahissent les regrets, les remords, l’angoisse. Qui a parlé ? Nul ne s’aventure à formuler de réponse.
On feint de discuter, mais chaque mot s’éteint avant d’être entendu. L’air, devenu trop lourd, rend chaque respiration poussive. La cheminée brûle, mais le froid s’installe. Une buée s’échappe des bouches soudainement pâles. Le vin tremble dans les verres. Le feu de l’âtre reflète une ombre n’appartenant à personne. Sa silhouette se dessine sur le mur, fine, assise… à la treizième place. Elle s’efface quand on la fixe, revient quand on se détourne. Elle s’installe. Seul l’enfant ne la quitte plus des yeux. Ses lèvres bougent, sans le moindre son.
Le père se lève, tout rire envolé. Il saisit l’assiette de trop, la retire de la table, l’emporte dans la cuisine. Quand il revient, l’assiette est revenue. Même place. Même couteau. Même tache sombre au bord du couvert. Un long frisson parcourt l’assistance. Les poitrines se serrent. Plus personne n’ose parler… mais tous s’épient. L’interrogation des regards se mue en terreur.
Les minutes s’allongent, se dilatent. Le tic-tac de l’horloge claque comme une menace. Les flammes s’éteignent une à une. La nappe devient linceul. Les visages se creusent, se durcissent. L’enfant continue de compter inlassablement en silence. Treize. Toujours treize.
Un murmure glisse entre les cloisons. Une respiration lente, posée au creux de chaque oreille. Les convives se crispent, certains se signent, d’autres serrent les poings. Personne n’ose regarder la chaise. Personne, sauf l’enfant.
Le chuchotement traverse la salle. L’enfant hoche la tête. Les autres feignent de ne rien entendre. Tous l’ont cependant perçu. Était-ce une promesse ? Une menace ?
À l’extérieur, la neige tombe à présent, épaisse, étouffant le monde. Les cloches de l’église battent minuit. Douze coups. Douze convives. Pourtant la treizième chaise se balance lentement en crissant.
L’enfant pleure sans bruit. Les adultes restent figés. Tous savent qu’il a raison et qu’aucun d’eux ne s’avisera de recompter. Dehors, la neige efface tout. Dedans, le silence se creuse.
La treizième chaise ne grince plus. Elle attend.